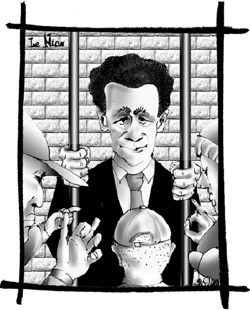
La question de “l’insécurité” est devenue en l’espace de quelques années la préoccupation principale des médias et des hommes politiques, de gauche comme de droite. Les motifs d’un tel consensus -démagogie, inconscience ou même intérêt financier- sont aussi divers que les formes de discours mais le fond est bien le même. Pourtant, ce qu’on pourrait appeler la “pensée unique sécuritaire” n’est pas uniquement le reflet des préoccupations des citoyens, c’est aussi un formidable outil politique qui aura permis la réélection d’un président contesté.
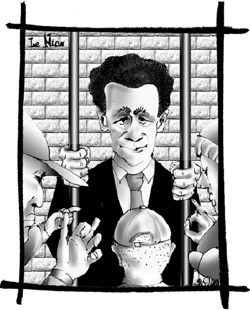
Fantasmes & réalités
“L’insécurité” est un concept flou, imprécis : c’est ce qui lui donne toute son utilité, chacun étant libre de le comprendre comme il le veut, de confondre la réalité et le “sentiment d’insécurité” exprimé dans les sondages. Par contre, les termes “insécurité” ou encore “violence” ne sont utilisés par journalistes et hommes politiques que pour désigner la délinquance des cités. Pas ici d’évocation de la délinquance financière, ni de l’insécurité de l’emploi ou encore de la violence des BAC (brigades anti-criminalité).
La délinquance des jeunes des quartiers pauvres n’a pourtant rien d’un phénomène récent. Le 20ème siècle a connu de très semblables apaches, blousons noirs et racailles. Même le racisme latent qui se cache derrière les discours stigmatisant les délinquants n’a guère évolué : les paysans qui fuirent les campagnes au 19ème siècle ont été victimes de cette même discrimination qui touchera ensuite les immigrés européens (italiens, portugais) et que connaissent aujourd’hui les enfants d’immigrés maghrébins.

“Violence sérieuse des jeunes entre eux, violence moins grave envers les institutions, consommation et trafic de drogues“ sont, d’après Laurent Mucchielli (voir liens), les trois phénomènes principaux d’évolution de la délinquance dans les dernières années. Ces changements ont des causes sociologiques ou juridiques évidentes. La montée du chômage, la “ghettoïsation” des banlieues, les tentations toujours plus nombreuses de la société de consommation, l’impunité des bavures policières ont beaucoup changé le climat social des quartiers populaires.
La criminalisation de la toxicomanie, les évolutions du droit des résidents étrangers, la criminalisation de certaines formes de militance, la dépénalisation des chèques sans provision ont eu leur influence sur les chiffres de l’institution judiciaire. Mais surtout, comme le rappellent la LDH et le Syndicat de la magistrature : “Les atteintes aux biens et aux personnes s’inscrivent dans un processus de précarisation d’un nombre grandissant de personnes, et ne pas en tenir compte revient à s’attacher aux effets sans remédier aux causes”.
De l’Etat-providence à l’Etat-policier
La gauche tenait traditionnellement le discours de la prévention, plutôt que de miser sur l’approche répressive. Pourtant, en octobre 1997 au colloque de Villepinte Des villes sûres pour des citoyens libres organisé par le tout nouveau gouvernement Jospin, les propos sont très différents : “la sécurité est une valeur de gauche”, elle sera donc la seconde priorité du gouvernement qui entend faire prévaloir “la responsabilité individuelle” aux “excuses sociologiques” [1].
Le nouveau discours sécuritaire de la gauche gouvernementale est en partie issu d’une vision pacifiée de la société, vision qui nie la violence des rapports sociaux, et dès lors, verrait plutôt la délinquance comme “le cancer social” d’un corps sain. Ce tournant, “victoire idéologique de la droite” selon le député Patrick Devedjian, est à rapprocher de celui amorcé par le PS dès 1983 en matière d’économie : la disparition de l’Etat-providence, le désengagement de l’Etat dans la gestion économique et sociale…
Ce sont dès lors les fonctions régaliennes de l’Etat (justice, police…) qui prennent le pas sur ces fonctions sociales, dans la voie tracée par les politiques néo-libérales anglo-saxonnes. C’est ainsi qu’aux Etats-Unis, le budget alloué aux hôpitaux diminue chaque année et celui des prisons augmente dans les mêmes proportions [2]. En annonçant la construction de prisons et en faisant du ministre de l’Intérieur sa figure de proue, le gouvernement Raffarin s’oriente vers une gestion sécuritaire à l’américaine.
La tolérance zéro, bien aimée des médias, fait partie de ce dispositif. Pourtant, les deux meilleurs spécialistes américains en la matière concluaient en 2000 leur étude commune en désignant la tolérance zéro comme le candidat le “moins plausible pour expliquer le recul de la criminalité [3]. La tolérance zéro est donc plutôt un argument démagogique qu’une solution politique : la formule fonctionne, les sondages l’indiquent.
Médias & sondages : le nouveau jeu politique
“Cette pratique des sondages, qui a un intérêt scientifique nul mais un rendement politique élevé, place, contre l’esprit même du système politique représentatif, la vie politique en situation d’élections permanentes. (…) Le rapport de délégation se trouve plus profondément mis en cause par la multiplication des sondages qui visent à faire trancher directement, sans débat ni discussion, par des individus atomisés et pour la plupart non informés, tout problème surgissant de l’actualité” [4]. Cette évolution du “jeu politique” peut avoir des conséquences funestes.
Au PS, c’est l’expert maison des sondages, Gérard Le Gall, qui signe en 1995 des notes internes appelant à changer de ton sur “l’immigration et l’insécurité” afin de “reconquérir” les votes “populaires”. Il est évident que le ”changement de ton” de la gauche gouvernementale a eu une influence sur le traitement médiatique de l’insécurité. La presse, auto-proclamée “4ème pouvoir”, a tendance, pour prouver sa légitimité et son indépendance à adopter des positions au centre, entre la gauche et la droite, et à abuser des sondages. Dans les rédactions, on se défend tout de même d’avoir jeté de l’huile sur le feu.
Pourtant, en terme d’impact médiatique, l’insécurité a diminué de 50% entre les deux tours par rapport à la période du 1er au 20 avril. A la télévision, cette diminution atteint 67% ! Prise de conscience tardive, peut-être… Il faut aussi noter que les journalistes ont beaucoup contribué -plus ou moins consciemment- à l’apparition du phénomène d’“insécurité“. Par exemple, la “tradition” des voitures brûlées le soir de la St Sylvestre dans les rues de Strasbourg est apparue seulement après qu’un fait divers sans grand intérêt ait subi le “coup de projecteur” médiatique. Créée et alimentée par l’attention particulière des médias, la “tradition” va elle-même créer et alimenter le sentiment d’insécurité, dans les quartiers concernés ou via le petit écran.
Et que dire de ces multiples reportages, aux cotés des forces de l’ordre, qui ont de sinistres retombées en termes d’image et de climat dans les quartiers visités, et qui ont contribué à développer la psychose sécuritaire ? “Les entreprises de la presse écrite et télévisée sont des entreprises économiques en concurrence pour vendre leurs produits ; cette concurrence (…) oblige (…) à aborder dans l’urgence les sujets traités par les concurrents, qui deviennent des sujets (…) de la conversation, au moins dans les milieux politiques et journalistiques. Cette nouvelle domination se laisse voir dans les excès qu’elle engendre” [5].
Pourtant, dans Le Monde du 16 mai 2002, PPDA se défend : “Pourquoi nous voiler la face ? Ces faits-là existent, en quantité plus impressionnante que naguère, nous disent les statistiques”.
Statistiques & experts
Les statistiques disent parfois ce qu’on veut leur faire dire. Les tant attendus chiffres du Ministère de l’intérieur n’indiquent pas grand chose sur l’évolution de la délinquance. Ce sont les chiffres de l’activité policière, et ils évoluent surtout au gré des gouvernements et des lois. Par contre, leur arrivée est une sorte de cérémonie médiatique, un évènement fabriqué pour que politiciens, politologues, journalistes et “experts” puissent y trouver l’espace ou partager leurs angoisses.
Ces derniers occupent évidemment une place privilégiée dans le débat. Pourtant, tout comme leurs confrères “spécialistes” du terrorisme, les “experts” des violences urbaines sont, par définition, dépendants de l’existence du phénomène qu’ils prétendent analyser. En témoigne l’alarmiste “Que sais-je ?” Violences et insécurité urbaines, véritable best-seller, dont la validité scientifique peut être mise en doute, ses auteurs n’étant nullement universitaires. L’un, Alain Bauer, se trouve être le patron d’AB Associates, cabinet privé de “conseil en sécurité urbaine”. Le second, Xavier Raufer, est journaliste et ancien militant d’extrême-droite.
Ce type d’association entre intérêts pécuniers et idéologiques est familier du débat qui nous intéresse. Autre exemple significatif : la commissaire Bui Trong, qui travaille aux Renseignements Généraux, est à l’origine d’une échelle d’évaluation des “violences urbaines” [6] que l’on peut qualifier de caricaturale (les attroupements dans les halls et les cages d’escalier en constituent le premier échelon) et de corporatiste (les troubles à l’ordre public et les violences à l’encontre de policiers y sont considérés comme bien plus grave que les violences entre jeunes).
La confusion entretenue dans ce tableau entre les violences “politiques”, c’est-à-dire celles qui visent les symboles de pouvoir, et les violences sur les biens et les personnes, majoritairement pauvres, n’est pas le fruit du hasard. Ni la présence des RG sur ce sujet. Suite à l’effondrement du bloc soviétique et à l’évolution des mentalités en matière de droits de l’Homme, les services de surveillance ont dû re-définir leur mission sur le territoire français. “L’ennemi intérieur” qui légitimait le fonctionnement opaque de telles organisations a changé de visage. Les banlieues sont le nouvel objectif, avec la menace de leur embrasement ou du terrorisme qu’elles sont censées abriter.
Finalement, elles permettront aux services secrets de conserver leurs crédits. Il semble clair que “le discours sécuritaire mobilise dans son élaboration des savoirs indissociables des appareils à vocation directement répressive (police, justice, sécurité privé)” [7]. De fait, “l’insécurité” se trouve au carrefour de réseaux d’intérêts diffus : experts, médias et politiques y voyant tantôt un gagne-pain, tantôt un cache-misère et surtout un outil particulièrement efficace pour contrôler la sacro-sainte opinion publique [8].
Il faut se rappeler que “la délinquance, avec les agents occultes qu’elle procure mais aussi avec le quadrillage généralisé qu’elle autorise, constitue un moyen de surveillance perpétuelle sur la population : un appareil qui permet de contrôler, à travers les délinquants eux-mêmes, tout le champ social” [9].
La “pensée unique sécuritaire” n’est pas née en un jour. Ce ne fut pas un complot qui a réuni médias, politiques et policiers sur ce point, mais des intérêts indépendants les uns des autres qui ont appris à se compléter parfaitement : “L’interpénétration des plans et des actes humains peut susciter des transformations et des structures qu’aucun individu n’a projetées ou créées. L’interdépendance entre les hommes donne naissance à un ordre spécifique, ordre plus impérieux et plus contraignant que la volonté et la raison qui y président” (Norbert Elias).
| [1] Lionel Jospin, Le Monde 07/01/99.
[2] Loïc Wacquant, Les prisons de la misère, Ed Raisons d’Agir (1999). [3] cf Le Monde Diplomatique de mai 2002, article de Loïc Wacquant, Sur quelques contes sécuritaires venus d’Amérique. [4] Patrick Champagne, Faire l’opinion, ed de Minuit, (1991). [5] Faire l’opinion, Ed de Minuit, (1991). [6] Le terme a d’ailleurs été inventé par les RG. [7] No Pasaran, Hors-série 1 spécial sécuritaire, voir l’article Radioscopie du discours sécuritaire. [8] Sur cette question de la validité de la notion d’”opinion publique“, je vous recommande particulièrement l’ouvrage de P.Champagne, cité plus haut. [9] Michel Foucault, Surveiller et punir, Gallimard (1975). |